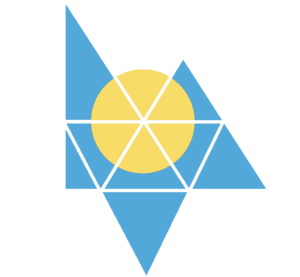(c) Légende
J’ai participé récemment à un déjeuner philo organisé par Formapart sur le bonheur au travail. La question posée à ma table était « le bonheur au travail est-il un gros mot ? ». Après quelques jours de recul, j’en garde un cheminement qui me plaît bien et que j’ai l’élan de partager ici.
Je précise que n’est pas un compte rendu fidèle de notre discussion mais plutôt une ré-interprétation personnelle de ce qui s’est dit. Merci à mes partenaires de jeu pour ce moment agréable et inspirant.
J’ai d’abord pu voir que le mot « bonheur » ne résonnait pas chez moi. Tout comme son acolyte « le malheur », qu’on lui oppose souvent, je le perçois comme une force mystérieuse qui me tombe dessus. Sur laquelle je n’ai aucune prise. Et ça me dérange.
Plutôt que de « bonheur », je préfère parler d’états intérieurs agréables. La joie, la sérénité, le rire, la paix… Je crois que ces états sont accessibles quels que soient les aléas de la vie. Quel que soit le cadre dans lequel j’évolue. Et surtout, je crois qu’il est de ma pleine responsabilité de les cultiver. En étant à l’écoute de moi. En allant consciemment dans le sens de mes besoins, de mes aspirations. En posant mes limites là où c’est nécessaire. En acceptant d’aller mal quand ça va mal.
Ce mouvement vers moi-même m’appartient.
Il est vrai que les environnements relationnels et professionnels dans lesquels j’évolue peuvent plus ou moins faciliter ce mouvement. Mais je ne crois pas qu’ils en soient la source. Je ne crois pas non plus qu’ils aient le pouvoir de m’en couper ou de m’en priver.
« Alors pourquoi on pourrait pas être heureux au travail ? »
« Parce qu’on n’a pas le choix », répondait une personne du groupe. « On est obligés de travailler pour (sur)vivre. C’est comme ça que la société fonctionne. »
Donc ici on parle du travail comme source de revenus. Le travail pour « gagner sa vie ».
Et c’est vrai que, dit comme ça, ça me donne pas envie de sauter de joie. Le mot « travail » en soi est déjà lourd pour moi. Il prend ses racines dans le lexique de la torture si je me souviens bien. Quelque chose de subi. Auquel on n’échappe pas. Pourtant je n’ai pas le sentiment de subir mon travail. Au contraire, je continue de le choisir chaque jour. Et j’y cultive régulièrement des états intérieurs agréables. C’est même mon principal baromètre pour décider si j’ai « bien bossé » ou pas. « Est-ce que j’ai pris plaisir ? »
Au fond, plus que le rapport au travail, tout ça m’évoque le rapport au cadre.
Ce cadre sociétal qui dit que « chacun doit gagner sa vie », je peux en effet le voir comme une limite à moi et à ma capacité de choix. Comme un espace fait uniquement de contrainte et de privation. Ou je peux en faire un espace de liberté. Mais pour ça, j’ai besoin de me l’approprier.
Plutôt que considérer la nécessité de « gagner ma vie » comme un boulet, j’aime y voir un chemin vers ma responsabilité individuelle et un moyen de contribuer au bien vivre ensemble. Là, il y a quelque chose qui s’ouvre. Parce que je connecte le cadre à mes besoins et mes aspirations. Ma liberté commence là. Dans le choix des mots et d’une perspective qui m’aident à cultiver des états intérieurs agréables.
Et aussi, je crois que les sources de revenus, ça se choisit. Ca se questionne, ça se transforme, ça se cumule, ça se quitte… ou ça se subit. Libre à moi de les utiliser pour nourrir mes besoins et aspirations profonds en plus de mon estomac. Ou de rejeter cette responsabilité vers l’extérieur. Entre les mains d’un patron, d’un gouvernement, de mes parents…
Une autre personne rebondissait sur cette notion de liberté. Pour elle, justement, le mouvement du bonheur au travail était surtout une gigantesque stratégie d’asservissement. Elle y entendait clairement un gros mot. Quelque chose de grossier et d’insultant.
Le point était à peu près le suivant : en faisant croire aux travailleurs que leur bonheur repose sur leur employeur et leurs conditions de travail, on les rend dépendants. On les coupe d’eux-mêmes. On les incite indirectement à bosser encore plus pour encore moins, et à dire merci à la fin.
Je vois bien la possibilité de cet effet pervers. Parfois, c’est peut-être même une stratégie de manipulation consciente, qui sait. Mais si c’est le cas, personne ne nous oblige à y succomber.
Restons dans le champ lexical du gros mot.
Si quelqu’un m’insulte, je garde le choix de ma réaction. Je peux lui péter la gueule, ou je peux baisser la tête, ou je peux reconnaître que cette insulte lui appartient tant que je ne la fais pas mienne. Comme dans cette histoire du vieux samuraï qui reste impassible devant les provocations de l’ennemi. Quand ses disciples lui reprochent sa lâcheté, il les questionne.
« Si quelqu’un vous tend un cadeau et que vous ne l’acceptez pas, à qui appartient-il ? ». Et eux de réaliser : « A celui qui vous l’offre ».
Au final, l’autre n’a de pouvoir sur moi que celui que je lui laisse.
Alors si je vis le bonheur au travail comme une agression, au point d’être aspiré dans une lutte ou dans un rôle de victime, qu’est-ce que ça vient éclairer chez moi ? Qu’est-ce qui fait que j’ai envie d’accepter ce cadeau empoisonné ? Et en conscience de ça, quels sont les choix à ma disposition, autres que la pulsion première d’y succomber ?
J’aime bien ces questions. Parce qu’ici encore, elles remettent la responsabilité entre mes mains.
A la lumière de tout ça, le bonheur au travail est-il un gros mot ?
Pour moi, la réponse est très connectée au sentiment de responsabilité individuelle.
Si je considère que je suis responsable de mes états intérieurs et de mon cadre de travail, alors le bonheur au travail est non seulement possible mais un destin qu’il m’appartient de cultiver. Je ne vois rien de grossier ni d’insultant là-dedans. Si en revanche, je décide que le bonheur doit plutôt venir de l’extérieur, en le remettant par exemple entre les mains d’un employeur, alors je me coupe de ma capacité propre à le nourrir. Je confère au “travail” le pouvoir de m’asservir, de me manipuler, de m’insulter.
Et le « bonheur au travail » devient, en effet, un “gros mot” absolu.
Articles connexes :
De votre rôle de dirigeant(e)
De votre vie en équipe